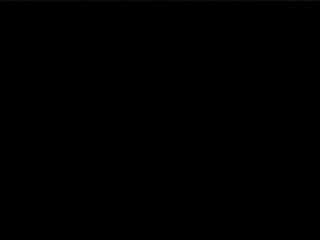Parfois,
je n'ai pas envie d'écrire sur les films que je viens de voir, soit
parce que je les trouve trop navrants et franchement pas rigolos,
soit par paresse, soit parce que je n'ai pas grand chose à dire.
Voici les films que j'ai vu ce mois de janvier parmi ceux sortis en
salles sur lesquels je vais me contenter d'écrire quelques lignes.
Joy
(David O. Russell, 2015)
Le
scénario de Joy
me fait penser à ceux que Scott Alexander et Larry Karaszewki
avaient écrit pour Tim Burton et Milos Forman (Ed
Wood, Larry
Flynt et Man
on the moon). Des hommes qui
luttent contre le système qui cherche à les broyer. Le personnage
de Jennifer Lawrence a aussi un rêve, fabriquer un balai qui
permettra aux femmes de faire le ménage plus vite. Et ceux qui
l'empêchent de mener son projet sont, pêle-mêle, sa famille
envahissante qui vit tous sous le même toit (disputes entre le père
– Robert de Niro – et l'ex-mari – Edgar Ramirez), les
investisseurs (Isabelle Rossellini), les fournisseurs qui veulent
l'arnaquer et la télévision où elle fera du télé-achat. Mais
contrairement aux films cités ci-dessus, Joy
ne fait que valider le bonheur du capitalisme libéral et le rêve
américain parce que le système, in fine, protège les rêveurs.
Creed,
l’héritage de Rocky Balboa
(Ryan Coogler, 2015)
C'est
assez rare pour le signaler, Ryan Coogler est né dix ans après le
premier Rocky,
tout comme Michael B. Jordan (très bon, j'espère qu'il trouvera
d'autres bons rôles) qui joue ici Adonis Creed, alias Donnie Johnson
pour préserver son anonymat. Après une adolescence délinquante,
Adonis est adopté par la veuve de son père (Phylicia Rashad, Clair
Huxtable dans la série Cosby
Show). Il devient un brillant
homme d'affaire et quitte cette vie bien rangée pour devenir boxeur.
Direction Philadelphie et le restaurant Adrian's tenu par Rocky
(Sylvester Stallone) qui vit dans les souvenirs des anciens films.
Tout Creed
sera donc un moyen de ses rappeler ce passé glorieux. Ainsi les
combats de boxe et les entraînements sont soignés mais la romance
entre Adonis et sa voisine du dessous est cucul la praline.
Spotlight
(Tom McCarthy, 2015)
Avec
un sujet pareil, je craignais le pire. Le sujet : des
journalistes d'investigation qui enquêtent sur un prêtre pédophile
à Boston, ville la plus catholique des Etats-Unis. Tout se passe en
2001 et cette poignée de reporters a bien du mal à trouver des
éléments tant la censure à la fois de la Justice, de la Police et
de l'Eglise leur met des bâtons dans les roues. La minutie du
scénario qui met le spectateur à la place que Michael Keaton, Mark
Ruffalo, Rachel MacAdams et Brian D'Arcy James, quarteron mené par
un nouveau rédacteur en chef (Liev Schreiber, d'une sobriété
redoutable), est remarquable. Le film est passionnant, précis et
d'une clarté appréciable. Je crois que la réussite de Spotlight
tient à un seul détail, essentiel mais rarement utilisé : ces
journalistes sont tous célibataires, pas d'atermoiements familiaux
pour poursuivre leur travail. Ces problème conjugaux, c'était ce
qui plombait L'Enquète de Vincent Garecq sur l'affaire
Clearstream.
Made
in France (Nicolas Boukhrief, 2014)
Les
rebondissements autour de la sortie de Made in France ont été
tellement nombreux qu'ils ont occultés que ce sujet, une cellule
djihadiste qui s'apprête à commettre un attentat a déjà fait
l'objet de plusieurs films, bien meilleurs, ces dernières années.
Hadjewich de Bruno Dumont (2009), We are four lions de
Christopher Morris (2010), La Désintégration de Philippe
Faucon (2001) et Les Chevaux de Dieu de Nabil Ayouch (2012).
On retrouve dans Made in France certaines scènes similaires à
La Désintégration : le nouveau prénom du jeune
converti, l'entraînement aux armes ou le rasage de la barbe pour
passer inaperçu. L'une des tentations du film est de jouer sur le
thriller, mais les dialogues sont toujours démonstratifs,
explicatifs et plats (les répliques entre Sam le journaliste et le
flic qui lui fait du chantage), chaque scène semble contredire la
précédente (après avoir demandé à tout le monde de passer
inaperçus, le gang décide de voler de quoi faire une bombe et tue
un policier alerté par l'alarme), les personnages sont des
archétypes et oublient leur but dès qu'ils se disputent (la scène
où Christophe alias Youssef ne veut pas qu'on jette sa télé). En
vérité, Made in France est tellement hors sujet qu'on se
rend compte que les personnages pourraient être basques, coiffeurs
ou fans de foot que le film serait pareil.