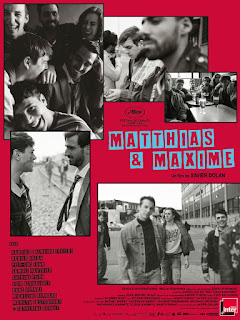J'en
reviens toujours pas de voir Robert Pattinson. Quand il a commencé à
jouer Edward Cullen dans les Twilight en 2009, il était,
encore plus que Taylor Lautner – le loup-garou de la franchise –
et Kristen Stewart – la nécrophile, puisqu'elle couchait avec un
vampire, devenue depuis l'égérie d'Olivier Assayas, la risée du
monde entier. Je suis plutôt ravi de voir que tout revient dans
l'ordre. David Cronenberg avait parfaitement capté dans Cosmopolis
l'effet miroir qu'il exerce sur le spectateur.
Robert
Pattinson fait la couverture des Cahiers du cinéma (pour Good
time des frères Safdie), joue dans le meilleur film de James
Grey (Lost city of Z), part dans l'espace pour Claire Denis
(High life) et file désormais sur un phare sur un îlot de la
Nouvelle Ecosse en compagnie de Willem Dafoe, barbu comme jamais,
rugueux à souhait, délivrant quelques pets dans l'espace exiguë
qui va leur servir quelques mois de domicile et de lieu de travail.
Le tout est filmé dans un noir et blanc ultra contrasté.
Ces
pets qu'on entend ne sont pas là pour faire rire, pas uniquement.
Cette trivialité permet au film de ne pas se prendre trop au
sérieux, de rester proches de ces personnages, surtout de celui de
Willem Dafoe qui débite des lignes entières de Herman Melville
avant chaque repas (de la morue et un légume, ça doit être ça qui
le fait péter) et d'avaler des litres d'alcool blanc. Ce que refuse
pour l'instant de faire son jeune apprenti qui se contente d'eau. À
voir le goût de l'eau, on comprend pour l'ancien boit de l'eau de
vie.
N'entendre
que les pets serait de mauvaise foi. Ce que le film de Robert Eggers
propose comme dispositif sonore est une sorte de corne de brume, un
haut parleur qui rugit jusqu'à en faire vibrer les fauteuils du
cinéma. C'est un avertisseur pour les bateaux tout autant que la
lumière du phare. Le son, court et sourd, est relayé par la musique
sinistre elle aussi. Tout à fait en adéquation avec l'image. Il
s'agit d'être cerné par un son dont on ne peut pas s'échapper,
auquel s'ajoute le ressac de la mer, les vagues qui s'échouent et
l'écume de l'eau.
L'îlot
est inhospitalier et l'aîné mène la vie dure à son cadet. Il est
toujours sur son dos, il lui donne des ordres, il le réprimande. Il
faudra un bon moment pour qu'on sache comment ces deux-là
s'appellent (ça change des dialogues où les noms et prénoms sont
donnés à chaque fin de phrase). Pour l'instant, le jeune est appelé
« young lad », « mon petit gars » par
l'ancien. Ce qui a le chic pour l'énerver. « Je m'appelle
Ephraïm Winbslow », lui dit Robert Pattinson de plus en plus
agacé. L'autre continue de la traiter comme un chien.
Un
chien, voilà ce qu'il est, rien de plus. Un chien avec des envies
profondes de sexe, un chien qui imagine voir sur les rochers une
sirène, il en rêve la nuit, hurle jusqu'à se réveiller. Un chien
qui se branlera devant l'image d'une autre sirène, en ivoire
celle-là, révélant la nudité de l'acteur dans des images
érotiques (oui, ça change des ridicules chromo de Twilight, ça
change d'Edward Cullen) dignes à la fois des magazines beefcake, de
Pierre & Gilles et un peu de Querelle. C'est cette charge
érotique que l'acteur apporte et qui va troubler la vie.
Voir
la lumière est interdit à Ephraïm, son Maître, Thomas Wake (enfin
on connaît le nom de Willem Dafoe), lui interdit. Tous les
stratagèmes sont bons pour amadouer Thomas. Ephraïm commence à
picoler avec lui, à chanter avec lui, ils dansent ensemble, dans un
étrange ballet. Rien n'y fait, il reste un chien, un petit gars.
C'est ce refus qui provoque la folie du jeune homme décrite
organiquement dans la confusion des plans qui s'entrechoquent. C'est
un film cerveau tout autant qu'un film phallus.
L'un
des personnages les plus importants du film est une mouette. L'oiseau
– bonjour Alfred Hitchcock – nargue Ephraïm. La mouette provoque
la malédiction qui s'abat sur lui dans un surgissement de violence
inouï. Tout bascule, la réalité comme le rêve. Et soudain, une
question survient, et si les deux hommes n'en étaient qu'un ?
Et si Thomas Wake n'était que Ephraïm Winslow vieux, dégénéré,
sénile qui s'invente un jeune compagnon comme l'autre s'imaginait
baiser la sirène pour masquer sa solitude. C'est la vision que j'ai
aujourd'hui de The Lighthouse. Demain ce sera peut-être une
autre.