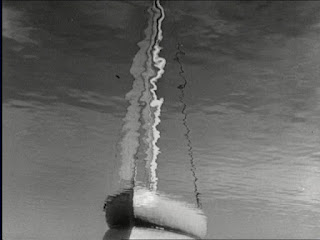Dernière
escale dans les courts-métrages documentaires (mais ce sont surtout
de charmantes comédies désuètes) de Bert Haanstra. Direction le
zoo, avec ses animaux et ses bêtes, soit les pensionnaires forcés
du zoo et les visiteurs, ce public hollandais qui vient en famille
voir ces animaux derrière les cages. 11 minutes avec une musique de
jazz axée essentiellement sur les trompettes (pour les humains) et
le saxophone (pour la faune). Visite guidée.
Le
film joue sur un motif très simple et forcément porteur de saillies
humoristiques, comparer les humains aux animaux. Ainsi dans un simple
champ contre-champ, les singes semblent faire les mêmes gros yeux
que ces deux bambins, les lions s'embrassent comme ce couple sur un
banc, cette dame a la même robe rayée que le cuir du zèbre. Etc,
etc... Dans Zoo, le cinéaste exprime une chose évidente, il ne
sait plus qui regarde qui, qui imite qui, qui rit de l'autre.
Parce
que le public du zoo n'est pas franchement calme. Les enfants se
moquent de ce singe qui n'a rien demandé, il provoque ce tigre
enfermé dans un enclos trop petit, il imite les grimaces de tel
animal. Le film montre, sous des images a priori comiques, la cruauté
de la situation. Le choix du free jazz comme musique est ainsi
destiné à appuyer les rapports tendus entre les proies et les
bourreaux, comme ces enfants qui narguent les fauves avant de prendre
peur.
Parmi
tous ces visiteurs très nombreux et en famille, le film s'amuse à
revenir régulièrement vers deux images. Ainsi ce vieux monsieur qui
passe son temps à tenter de photographier un perroquet et ces deux
vieilles dames qui discutent au lieu de visiter, elles en ont des
choses à se dire. Le film se termine sur ce petit singe terrorisé,
coincé dans un coin de son enclos. Mais dans le dernier plan, il
tire la langue au spectateur dans un ultime regard caméra vengeur.