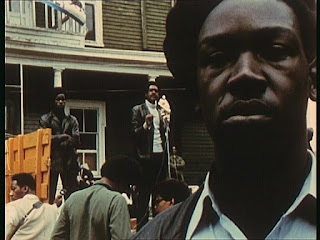Puisque
Arte diffuse depuis quelques jours Cléo de 5 à 7, jetons un
petit coup d’œil aux aventures de Florence (Corinne Marchand)
alias Cléo, jeune chanteuse en herbe qui a sorti trois 45 tours.
C'est à la toute fin qu'on découvre son vrai prénom, elle le
révèle à un jeune homme rencontré dans le parc Montsouris, un
garçon à la voix douce (Antoine Bourseiller), la chemise ouverte en
cette fin de journée d'été, le jeune homme met ensuite son
uniforme, c'est un appelé, le soldat doit partir en Algérie le
soir-même.
La
guerre d'Algérie, quand Agnès Varda tourne son deuxième
long-métrage, n'est pas un sujet abordé par le cinéma français.
Loin de là, censure oblige (Le Petit soldat). Pourtant le
conflit est évoqué deux fois dans le film. En début de parcours,
Cléo et Angèle (Dominique Davray, l'actrice jouait Madame Mado la
proxénète des Tontons flingueurs), la dame à tout faire,
une sorte de surveillante générale bienveillante mais consciente
des petits caprices de sa vedette en devenir, sont dans un taxi
(caméra subjective pendant le trajet) et la chauffeuse du taxi a mis
la radio.
Ce
sont les infos, le journal radio qui informent de la guerre en
Algérie tellement loin des préoccupations de Cléo que la caméra
va suivre pendant ces presque deux heures. Deux heures de sa vie de
la visite chez la voyante jusqu'à l'hôpital, soit de la
superstition à la science. Mais c'est la voyante, attentive à son
angoisse, la regardant droit dans les yeux, bien plus que le médecin
qui fonce dans sa voiture décapotable, qui s'intéresse au destin de
Cléo, à ce cancer qui va semble-t-il la ronger. La préoccupation
majeure de Cléo est cette maladie et cela occupe tout son esprit.
L'idée
du film est que la jeune femme se sent seule même accompagnée.
Passé le prologue (la seule séquence en couleurs du film), Cléo va
d'un lieu à un autre, toujours accompagnée. Avec son ange gardien
la bien nommée Angèle. Elle achète un chapeau et badine dans la
boutique. C'est une multiplication de miroirs dans un élan
narcissique qui rappelle à Cléo le trouble dont elle souffre. Puis
chez elle, un logement totalement irréel sorte de cage dorée au lit
à baldaquin, où elle fait de la balançoire. On pense à la chambre
de Peau d'âne.
Elle
reçoit la visite de son musicien (Michel Legrand) et de son parolier
(Serge Korber) qui improvisent au piano. Cléo chante une chanson
triste « seule, laide et livide », clame Cléo regard
caméra à qui veut l'entendre. Elle jette sa belle perruque blonde
et revêt une robe noire. Comme la profusion de miroirs, ce sont les
regards caméra qui scandent la plupart des scènes du film. Il se
dégage une mélancolie qui va s'estomper au fur et à mesure que la
journée se termine, et c'est quand elle se promène avec Dorothée,
son amie modèle, que sa situation change quand Dorothée brise son
miroir.
Beau
moment, lors de la visite au cinéma où le fiancé de Dorothée
projette ce fameux court-métrage avec Jean-Luc Godard et Anna Karina
et plein d'autres amis d'Agnès Varda. Ce que je trouve aussi très
beau ce sont ces longues déambulations artères de Paris, les
publicités, les enseignes et les trognes. C'est un puissant objet
documentaire qui se projette sous les yeux des spectateurs, le tout
découpé en chapitres. On découvre, on se rappelle, on aperçoit ce
Paris de 1961, voilà aussi où gît la beauté du film. Comme je
l'écrivais vendredi, Agnès Varda n'est jamais meilleure que dans sa
veine naturaliste et documentaire.